Neurodivergence. De l’utilité d’un diagnostic
C’est une phrase que j’entends souvent en cabinet, affirmée sans ambage, comme un paravent devant la souffrance ou le chamboulement qu’un tel diagnostique pourrait provoquer. Parfois, ces paroles sont accompagnées d’un silence lourd ou d’un regard qui se détourne.
Elles révèlent une tension profonde : la peur d’être réduit.e à un mot, enfermé·e dans une case, limité.e à un diagnostic. La peur que ce mot devienne le seul filtre à travers lequel les autres nous voient.
Cette réticence est compréhensible. Dans nos sociétés où la norme dicte souvent le rythme de nos vies, « être soi » peut sembler un acte de rébellion silencieuse. La différence fait peur, et se nommer, c’est parfois se montrer vulnérable.
Mais cette phrase cache aussi une autre réalité : beaucoup se définissent par la négative, en réaction à un monde qui se contente de catégories tronquées — neuroatypie, religion, identité professionnelle… Chacune de ces réactions reste en surface. Elles ne touchent pas le cœur du sujet.
Car dans le champ de la neurodivergence, un diagnostic n’est pas une étiquette : c’est une clef. Une clef qui ouvre des portes longtemps fermées, éclaire des zones d’ombre, donne du sens à un parcours souvent chaotique et incompris.
Étiquette vs clef : une distinction essentielle
L’étiquette est un regard de l’extérieur
Une étiquette fige. Elle dit :
Elle réduit la complexité d’un parcours humain à un mot, un code, une case. Elle sert surtout celui qui la pose, pas celui qui la reçoit.
Décidez-vous que ce soit une étiquette ou bien un jalon dans votre cheminement intérieur, une étape vous permettant de mieux vous connaître ?
Accorder de l’importance aux étiquettes, c’est laisser l’extérieur diriger votre vie y compris dans un sens qui est contraire à celui de votre bien. Nous ne sommes jamais gagnants à rester sourds à nos besoins de nous connaître pleinement.
La clef : un outil d’émancipation de l’intérieur
Une clef, en revanche, on se l’approprie. Elle éclaire, elle explique, elle donne des pistes. Le diagnostic de neurodivergence — qu’il s’agisse d’autisme, de TDAH, de troubles DYS, de haut potentiel intellectuel ou d’autres modes de fonctionnement atypiques — fonctionne comme une clef :
-
elle donne du sens : enfin, les moments où l’on se sentait « à côté », « trop », « pas assez » trouvent une explication.
-
elle ouvre des possibles : accès à des aménagements, à des stratégies adaptées, à une communauté.
-
elle libère de la culpabilité : ce n’est ni un manque de volonté, ni de caractère, ni d’intelligence.
-
elle permet l’auto-compassion : comprendre son fonctionnement, c’est s’offrir de la douceur envers soi-même.
Une clef n’enferme pas, elle éclaire. Elle transforme la perception de soi, elle reconnecte avec ce qui est vivant en nous.
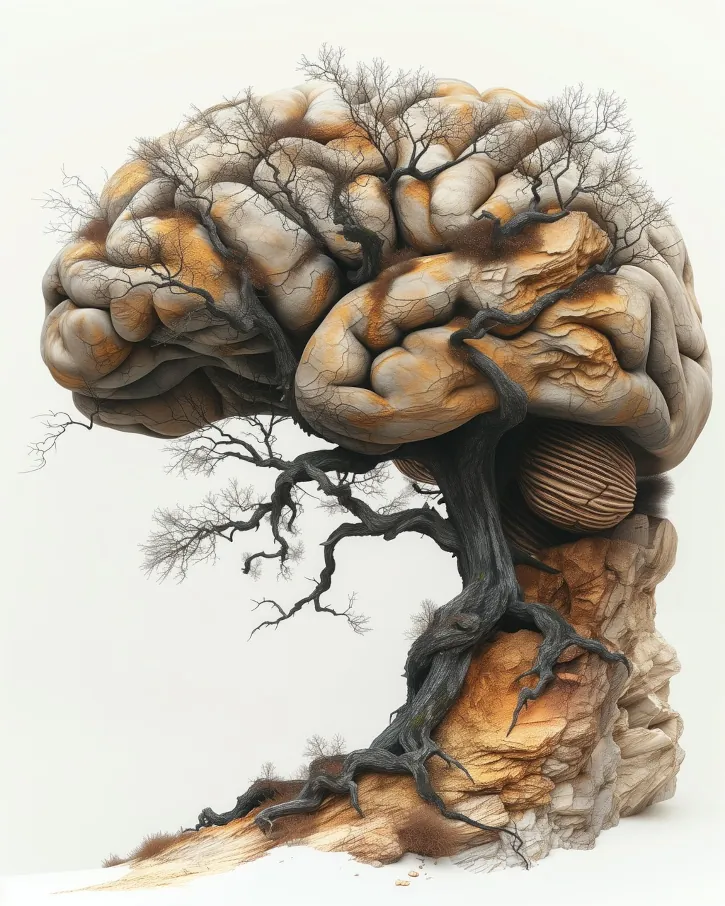
Enfin, ça a un nom : soulagement et réorganisation intérieure
Avant le diagnostic, beaucoup de personnes vivent une errance identitaire et émotionnelle. Elles sentent qu’elles sont différentes, mais ne comprennent pas pourquoi. Pour s’adapter, elles développent des stratégies de compensation épuisantes, multiplient les efforts pour « rentrer dans le moule ».
Cette fatigue de la sur-adaptation a un coût considérable en terme de conséquences difficiles pour la personne neurodivergente.
Les personnes neuroatypiques entendent souvent et depuis leur enfance :
ou au contraire :
Ces remarques s’internalisent. Le discours intérieur devient impitoyable :
Le moment du diagnostic est souvent un basculement important de la tendance importante à se dénigrer et se dévaloriser.
Tout se réorganise. Le passé se réécrit à la lumière de cette compréhension nouvelle : les crises de larmes à l’école, l’incapacité à suivre plusieurs consignes, les obsessions, l’hypersensibilité sensorielle ou émotionnelle, etc. Tout prend sens.
Le soulagement est immense.
« Je ne suis pas fou/folle. Je ne suis pas fainéant·e. Je suis neurodivergent·e. »
Du sens, des droits, des stratégies : avantages concrets
Le diagnostic de neurodivergence offre des bénéfices tangibles, bien au-delà du simple mot posé. Ces bénéfices sont indispensables à la santé mentale de ces personnes.
1. La reconnaissance officielle et l’accès aux droits
Un diagnostic ouvre l’accès à des mesures concrètes :
Durant la scolarité et à l’université :
-
Tiers-temps aux examens
-
Utilisation d’outils numériques spécialisés
-
Aménagements de l’environnement
-
Accompagnement spécifique (AVS, AESH)
-
Plan d’accompagnement personnalisé (PAP) ou projet personnalisé de scolarisation (PPS)
Au coeur de la vie professionnelle :
-
Reconnaissance RQTH
-
Aménagement du poste, adaptation des horaires, télétravail
-
Accompagnement par Cap Emploi ou des structures spécialisées
Dans le cadre administratif :
-
Allocation adulte handicapé (AAH)
-
Prestation de compensation du handicap (PCH)
-
Carte mobilité inclusion (CMI)
Ces mesures ne sont pas de simples formalités : elles permettent réellement de vivre dignement, d’exercer une activité professionnelle, de réussir ses études et de développer son autonomie.
Elles sont indispensables – comme je le disais plus haut – afin que la santé mentale de la personne soit prise en compte. La fatigue de la sur-adaptation mène à des comorbidités aussi tragiques que la dépression.
2. Accès à des stratégies adaptées
Au-delà des droits, le diagnostic offre également un accès à des stratégies adaptées à chaque profil neurologique.
-
Pour une personne avec TDAH, il s’agira, par exemple, d’apprendre à organiser son temps avec des minuteurs, à externaliser sa mémoire de travail à travers des listes ou applications, à fractionner les tâches en micro-étapes et à accepter le besoin de bouger pour mieux se concentrer.
-
Pour une personne autiste, il pourra s’agir de structurer son environnement et ses routines, d’utiliser des outils de communication visuelle, de prévoir des temps de récupération sensorielle et d’expliciter les codes sociaux implicites.
-
Pour une personne à haut potentiel, comprendre son fonctionnement peut signifier nourrir son besoin de complexité et de stimulation intellectuelle, apprendre à ralentir, développer son intelligence émotionnelle et trouver des pairs intellectuels avec qui partager ses réflexions.
Comme vous pouvez le voir, ces dispositions vont dans le sens d’assurer le bien-être intérieur de la personne neurodivergente.
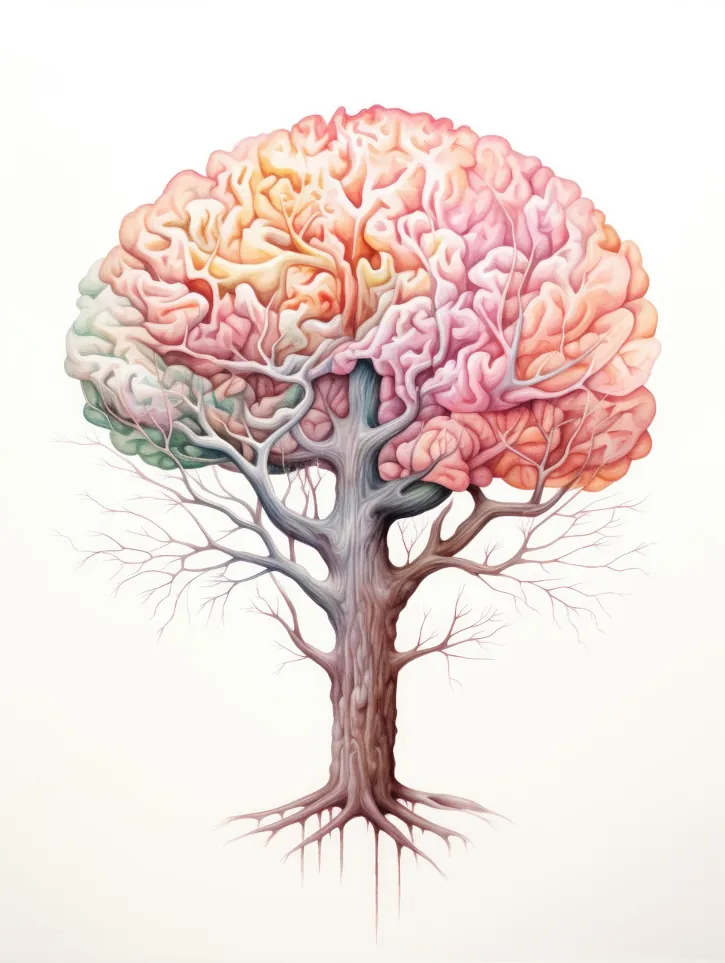
3. Fin de l’isolement : l’accès à la communauté
Enfin, le diagnostic permet de sortir de l’isolement. Rencontrer d’autres personnes neurodivergentes, que ce soit dans des groupes de parole, des associations ou des communautés en ligne, offre une validation précieuse.
Pour la première fois, il est possible de partager des expériences sans avoir à expliquer ni justifier, de trouver soutien et compréhension.
Face aux personnes neurotypiques, le diagnostique permet aussi de poser des mots, de faire œuvre de psychopédagogie auprès d’elles. C’est un aspect non négligeable pour se préserver des quiproquos, des incompréhensions, des quolibets et des reproches. Pouvoir dire : « je ne peux pas faire telle chose car je suis autiste et cela est trop compliqué pour moi », est un confort à nul autre pareil…
Et par-dessus tout, le diagnostic transforme profondément le regard sur soi.
4. Transformation du regard sur soi
L’équation est très simple :
-
Avant : honte, culpabilité, confusion, retrait social, dépression…
-
Après : compréhension, acceptation, clarté, ouverture au monde, bien-être…
Le diagnostic change le rapport à soi et à sa différence, catalyseur d’une nouvelle manière d’habiter sa vie.
Défis du parcours et libération
Le chemin vers un diagnostic est loin d’être simple. Il est souvent long et semé d’embûches. Les délais d’attente peuvent être considérables, parfois deux ou trois ans dans le public pour un diagnostic d’autisme, plusieurs mois pour un bilan neuropsychologique complet dans le privé.
Il n’y a pas assez de structures permettant l’accueil et le dépistage des neuroatypiques parce que nos institutions patriarcales et maltraitantes ne sont pas assez disposées à fournir les moyens financiers et matériels pour que les personnes ordinaires aillent mieux.
De surcroît, le coût peut également être prohibitif, allant de 300 à 1 500 euros selon la complexité et le type de professionnel. Le manque de praticiens formés reste un obstacle majeur, notamment concernant les profils atypiques, comme les femmes autistes ou TDAH, les personnes TDAH sans hyperactivité ou les profils doublement exceptionnels (autiste avec des traits HPI et/ou TDAH).
Beaucoup de personnes traversent une errance diagnostique, accumulant des étiquettes erronées – dépression, anxiété, trouble bipolaire ou trouble de la personnalité – avant d’obtenir enfin un diagnostic clair.
En plus des obstacles pratiques, le processus est émotionnellement exigeant. Se faire diagnostiquer implique de raconter son histoire à plusieurs reprises, de replonger dans des souvenirs douloureux, d’accepter l’évaluation et l’observation, et de vivre dans l’incertitude pendant des semaines, des mois, voire des années. L’attente la plus éprouvante est pour les
Certaines situations peuvent réveiller d’anciennes blessures ou générer des tensions dans les relations personnelles. Même si le diagnostic offre protection et droits, il peut exposer à des discriminations : refus d’embauche, plafonds de verre, remarques infantilisantes au travail, minimisation ou refus de soins dans le domaine médical, ou tensions dans la sphère familiale, etc…
Enfin, le choix de divulguer ou non son diagnostic reste profondément personnel. Certaines personnes décident de le partager ouvertement pour sensibiliser et revendiquer leur différence, d’autres préfèrent une divulgation sélective, et certaines gardent leur neurodivergence invisible. Aucun choix n’est intrinsèquement meilleur qu’un autre : il s’agit de préserver au mieux sa sécurité et sa santé mentale.
Nommer pour se libérer : un acte d’émancipation
Le diagnostic a une dimension existentielle.
Mettre un mot sur son expérience libère :
On sort de l’indicible, on valide ce que l’on ressent, on cesse de s’auto-critiquer.
La relecture du passé permet de contextualiser la douleur, de l’intégrer dans une histoire de vie cohérente. Donner du sens est ce qui permet de sortir de la souffrance. La personne traverse un deuil — de l’enfance non reconnue, de la trajectoire linéaire imaginée — pour renaître ensuite avec une identité neurodivergente positive.
Embrasser cette identité, c’est refuser d’être défini uniquement par un regard normatif extérieur. C’est affirmer :
Une identité positivement intégrée n’enferme pas ; elle ouvre sur le monde.
Conclusion : la clef ouvre des portes
Le diagnostic n’est pas une fin. Il ouvre la voie :
-
Vers une meilleure compréhension de soi
-
Vers des adaptations concrètes
-
Vers une vie plus alignée
Et peut-être, plus largement, vers une société qui célèbre la diversité neurologique plutôt que de l’effacer.
Le rêve éveillé libre et la neurodivergence : un accompagnement complémentaire
Dans le cadre d’une cure de rêve éveillé libre, il arrive que des éléments récurrents dans les rêves, des difficultés spécifiques ou des fonctionnements particuliers amènent à questionner une possible neurodivergence. Le travail par l’image et le symbole peut faire émerger des compréhensions nouvelles sur son fonctionnement propre.
Si cette hypothèse se dessine au fil des séances, je peux être amenée à vous orienter vers un dépistage ou un diagnostic, en complément de votre cure. Cette démarche n’interrompt pas le travail thérapeutique en rêve éveillé libre, bien au contraire : elle peut l’enrichir et permettre de mieux adapter l’accompagnement à vos besoins spécifiques.
Le diagnostic et la thérapie ne s’opposent pas, ils se nourrissent mutuellement. Comprendre son fonctionnement neurologique peut éclairer le sens de certaines images ou résistances rencontrées en rêve, tandis que le rêve éveillé libre offre un espace où la neurodivergence peut s’exprimer sans jugement, dans toute sa richesse symbolique.
Si vous vous reconnaissez dans cet article et vous questionnez sur un diagnostic, n’hésitez pas à en parler à un professionnel formé. Le chemin peut sembler intimidant, mais vous avez le droit de comprendre votre fonctionnement et d’accéder aux soutiens nécessaires.
Crédits photos, dans l’ordre : Deltaworks, Gugacurado sur Pixabay
Le rêve éveillé, pour qui ?
Des réponses sur la page Mes accompagnements
Entreprendre une cure en rêve éveillé libre, partie 1
Entreprendre une cure en rêve éveillé libre, partie 2
Des repères pratiques et concrets
Consulter la FAQ
Également la page Mes accompagnements
La formation du thérapeute en rêve éveillé libre
La formation de psychopraticien en rêve éveillé libre dispensée par l'ADREL
Un article sur l'obligation de thérapie, comme gage de sérieux


0 commentaires